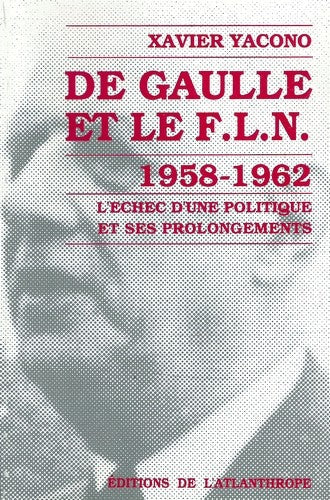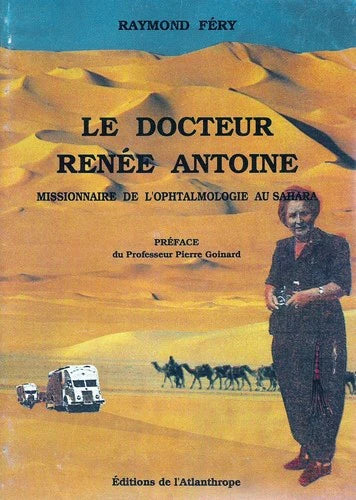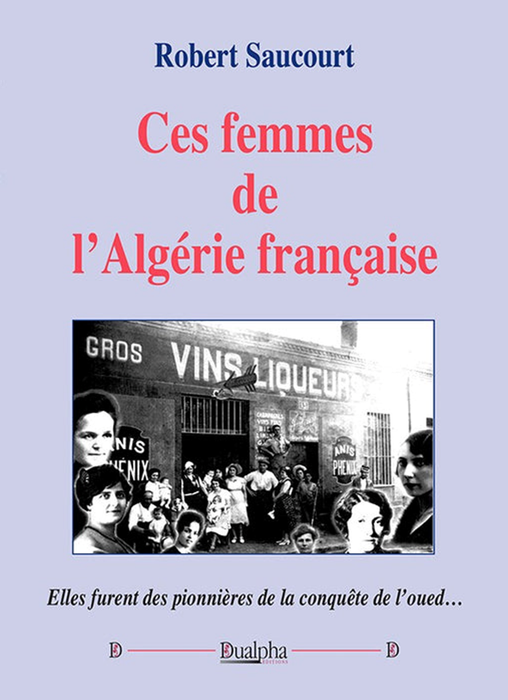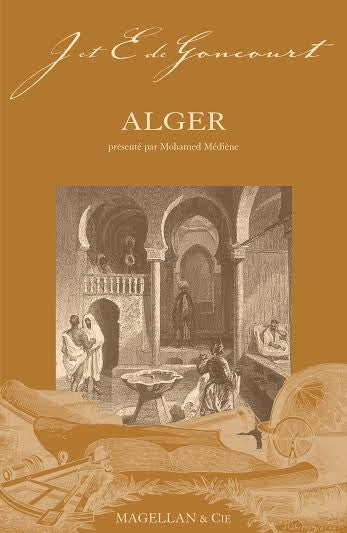
Alger
Les frères Goncourt, Edmond (1822-1892), l’aîné taciturne et paternellement protecteur de Jules (1830-1870), le cadet spirituel et espiègle, forment l’un des couples les plus originaux de la littérature française. Avec une incroyable complicité gémellaire, en analystes sérieux, ils dissèquent le Second Empire de cette pointe acide, perfide diront certains, qui est leur marque de fabrique. Leur vocation naît à Alger où, jeunes hommes de vingt ans qui se voyaient peintres, ils se rendent pour leur premier voyage en 1849.
Au moment où ils posent les pieds à Alger, les Goncourt sont au début de leur vie d’écriture. Ce voyage initiatique marque chez eux le double passage à l’âge d’homme et à l’état d’écrivain. Alger, au lieu de confirmer leur vocation de peintre, déclenche la tentation d’écrire. C’est là, dans « le cœur de la ville arabe », d’une fenêtre « qui domine la Méditerranée, immense et bleue », que s’impose à eux leur destin par un détournement malicieux : ils peindront, certes, mais avec des mots.
Ils renoncent au grand art pour se consacrer à l’observation minutieuse, presque clinique, de leur époque, et ils s’essayent à la littérature pour la première fois dans la ville blanche, devenue colonie française depuis moins de vingt ans.
Mohamed Médiène présente ici les textes que ce séjour ensoleillé leur a inspirés et dont ils garderont une nostalgie toute leur vie.
Format 20.3 x 13.3, 86 pages.
Magellan et Cie, Mai 2011.